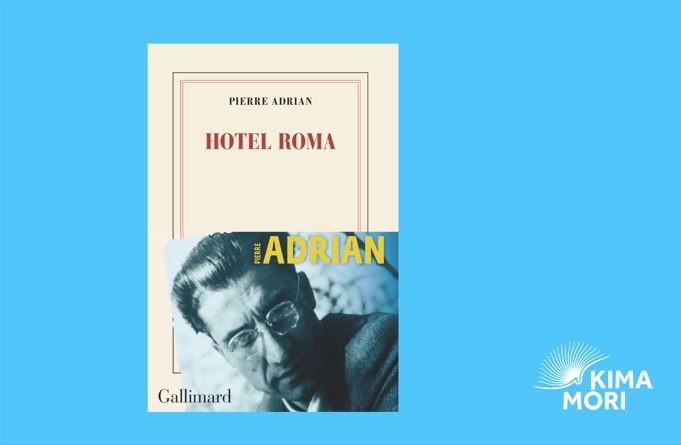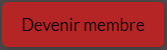Une chambre d’hôtel à Turin
Le 27 août 1950, on a découvert dans sa chambre d’hôtel le corps sans vie de Cesare Pavese. La ville était déserte ; la chaleur accablante avait éloigné les rares touristes et les habitants étaient tous au bord de la mer. Cette mer que Pavese n’aimait pas, qu’il avait dû « subir » quand, déporté en Calabre par le régime fasciste, il avait vécu tout près d’elle. Pavese était des Langhe, ces collines piémontaises autour d’Albe, que chante Beppe Fenoglio, son quasi contraire, résistant courageux dont les récits méritent qu’on s’y arrête.
Pavese a certes connu l’exil dans les années trente, mais il n’a pas participé aux combats des partisans à partir de 1943. Sans être entièrement « dégagé », il ne se sentait pas impliqué dans la lutte pour la libération de l’Italie. Si l’on voulait jouer avec les mots, on dirait qu’il ne se sentait libéré de rien, et surtout pas du poids de l’existence. Il était seul, il ne s’aimait pas, il aimait avec difficulté et connaissait l’échec presque tout le temps. Ses relations avec les femmes étaient brèves et douloureuses.
Dans Hotel Roma, tout commence à Dieppe, lors du confinement de 2020. Le narrateur s’y morfond, lit celui qui a tenu son journal, parlé de son métier de vivre, et qui ouvre une nouvelle décennie : « Cesare Pavese devint l’écrivain de mes trente ans sans doute parce que je ne cherchais plus de maitre à penser mais seulement un ami pour me tenir compagnie ». De Normandie, où « les aubes ressemblaient toutes à celles d’un dimanche », il se projette à Turin, dans cet hôtel qu’il visitera plus tard, dans une seconde partie qui relate les derniers jours de Pavese. La première partie est un voyage sur les traces de l’écrivain italien, livres en main. Travailler fatigue, son recueil de poèmes, Le métier de vivre son Journal, la correspondance, les romans, tels sont les bagages de Pierre Adrian. Il cite souvent les textes sans que jamais cela semble pédant, ou que l’érudition prenne le dessus. Ces livres l’accompagnent et le récit qu’il fait nous accompagne. On a envie de sortir les livres de sa ou de la bibliothèque, de partager avec d’autres ce que Pavese écrit. Ainsi, quand celui qu’on qualifie de misogyne (et son Journal en atteste trop souvent) s’adresse à un amour heureux du dernier printemps : « Penser à toi n’est pas en accord avec un souvenir ou une idée indigne, laids. Je t’aime.
Chère Connie, de ce mot, je sais tout le poids – l’horreur et l’émerveillement – et pourtant je te le dis, presque avec tranquillité. J’en ai si peu usé dans ma vie, et si mal, qu’il est comme neuf pour moi ».
Pavese était resté en adolescence, incapable par exemple de cuisiner ou de repasser une chemise. Il dépendait des autres, et à Serralunga, en ses terres natales, de sa sœur. Mais cette incapacité même a de quoi toucher le jeune romancier français.
De Turin ils se rendent à Rome où l’écrivain, traducteur et éditeur aidait à reconstruire la maison Einaudi. Ils vont en Ligurie où l’intelligentsia italienne (et Marguerite Duras parmi des français) passaient l’été, sur la plage, en Calabre, et reviennent dans cette campagne piémontaise où tout commence, où tout se passe, où tout aurait pu être différent.
Le récit d’Adrian s’embarrasse peu d’artifice. Il est seulement question d’une « fille à la peau mate » avec qui il voyage, avec qui, aussi, l’amour semble beau, contrastant avec celui de l’ami Pavese. Leur première rencontre est faite de partage, films et livres : « C’est ce qu’il y a de plus beau dans une liaison qui commence, le désir immédiat de deviner la réalité de l’autre en comprenant ses fictions ». La cité du Piémont deviendra leur ville, ils aimeront trainer : « Je soumettais de vains détours à nos vagabondages amoureux ». L’imparfait qu’emploie Pierre Adrian semble là pour faire durer ces moments. C’est le temps dont il use le plus souvent dans ces pages, comme si rien n’avait de fin. Sa conclusion vaut pour tous les amoureux : « Il faudrait qu’il existe comme ça des lieux où le souvenir est si fort qu’on puisse avoir la certitude de réparer l’amour en s’y rendant. Turin serait notre forteresse. Elle était imprenable ».
Mais Pavese est loin d’être un homme seul. Il suffit de lire ce qu’en écrit Natalia Ginzburg dans son « Portrait d’un ami »[1] ou Italo Calvino dans sa correspondance[2] pour mesurer l’influence de ce maitre discret. Et si l’on veut découvrir un Pavese encore autre, on lira le superbe roman de Tezer Özlü, La vie hors du temps, voyage sur les traces de Kafka, Svevo et Pavese[3], qui gagne à être connu, lu ou relu.
Le livre de Pierre Adrian refermé, on a l’impression que Pavese est là, dans la pièce silencieuse qui nous a servi de refuge face au bruit, face au monde qui vit dans le présent, la vitesse, l’instantané. On se sent bien, malgré un soupçon de tristesse.
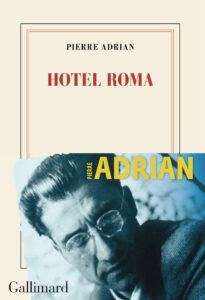 HOTEL ROMA
HOTEL ROMA
Pierre Adrian
éd. Gallimard 2024
Sélections Prix Femina et Prix Interallié 2024
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.