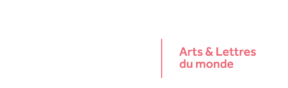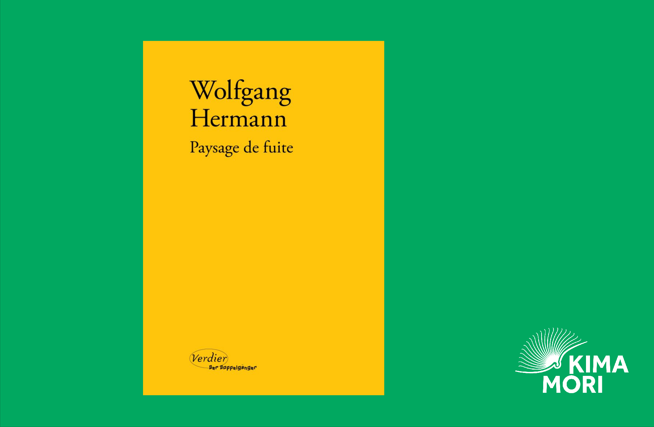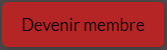Entre la vie et ailleurs
Wolfgang Hermann est né près de Bregenz, sur le lac de Constance. Il a étudié la philosophie, a vécu à Paris, au Japon et en Sicile. Il habite Vienne mais comme son héros il a besoin de se déplacer pour vivre et écrire.
De lui, nous pouvons déjà lire deux récits traduits par Olivier Le Lay, son fidèle traducteur. L’adjectif fidèle n’est pas galvaudé. Pour un auteur non francophone, il est le passeur, le seul qui puisse faire rayonner l’œuvre. Celle de notre écrivain autrichien, c’est d’abord Adieu sans fin. L’écrivain relate la mort soudaine de son fils âgé de seize ans, une nuit, dans la maison que tous deux occupent. L’auteur est séparé de la mère, le garçon va et vient entre ses deux parents. Le récit est poignant, sans emphase, sans désir d’apitoyer le lecteur. C’est une sorte de stèle élevée à la mémoire de Florian, ce « Florian qui vivra toujours en moi », comme l’écrit Wolfgang Hermann en ouverture de Paysage de fuite. Mais un livre de deuil ne fait pas une vie. L’auteur a voulu renoncer à l’existence. Il a continué de vivre, d’écrire, inventant un personnage habitant Bregenz, personnage à la Robert Walser, ou pour se faire une image, une sorte de Buster Keaton ou de Plume, personnage d’Henri Michaux.
Monsieur Faustini part en voyage est donc le deuxième livre que nous pouvons lire et d’autres aventures du personnage ont déjà paru en Allemagne. Attendons les traductions. Pour le moment, entrons dans ce Paysage de fuite.
Cette expression apparait dans un passage en italiques, écrit à la troisième personne. On les lira comme des pages de l’écrivain qu’est le narrateur. Beaucoup de ces extraits, moments d’un texte en construction se lisent aussi comme des poèmes en prose. Le paysage y occupe une large place.
Au moment où commence le récit, le narrateur est dans la chambre d’hôpital c’est-à-dire « hors du temps ». Il se sait dans un « nulle part » car, comme il l’écrit, « Il n’existe qu’une seule chambre d’hôpital au monde, c’est la même en tous lieux ». Et puis, nous le savons depuis « Les fenêtres » de Mallarmé, la chambre d’hôpital est aussi le symbole d’une vie. Cela vaut pour le narrateur, comme on le verra.
Un enfant, les femmes, l’écriture, les lieux : c’est tout son monde. Ce sont aussi toutes ses contradictions ou les raisons d’un déchirement qui le laissent continuellement intranquille. Ajoutons la présence des morts, et en particulier celle d’un frère parti très tôt de la maison familiale près du lac de Constance, et dont le père ne prononçait plus le prénom. Un frère peintre dont les toiles restent énigmatiques, un frère qui vit dans l’intensité : « Quoiqu’il entreprît, mon frère avançait toute garde baissée, engageant sa vie nue. Je l’ai vu combattre. Il terrassait l’adversaire ».
Mais l’enfant, d’abord. Il se prénomme Marc. C’est le fils qu’il a eu avec Elena. Il s’est séparé de la mère mais a un temps gardé l’enfant près de lui. Il le voit grandir, apprendre, prend conscience de ce bonheur partagé : « J’éprouvai, pour la première fois, assis là avec Marc, la sensation de n’être pas désamarré de tout. Mon enfant avait fait de cette ville, ma ville ». L’enfant est sa boussole, sans lui, il n’est « rien ».
La vie avec Elena est tout sauf paisible. C’est une femme séduisante, séductrice, impulsive, parfois brutale dans ses paroles. La violence succède à l’intensité amoureuse, en Sicile, en des scènes qui rappellent certains films italiens de Rossellini ou Antonioni. Le cadre de l’île est à cet égard parfait. La rupture entre les deux amants est dite dans l’usage de l’asyndète, cette figure qui consiste à supprimer toutes les liaisons logiques, à user du point ou de la virgule alors plus tranchants, catégoriques.
On se tromperait toutefois à faire porter le poids de la rupture sur la jeune femme. Certes, elle mène une existence peu compatible avec la vie qu’attend un enfant, mais le narrateur n’est pas le partenaire idéal. Son besoin d’écrire, impérieux, l’amène à « rouler vers l’abîme » en se séparant de Marc qui retrouve sa mère. Le narrateur étouffe dans cette existence pourtant heureuse avec l’enfant.
On le suit dans ses « paysages de fuite ». Il trouve le temps lors de son périple erratique de reprendre une écriture trop morcelée. La Tunisie qu’il traverse est une terre plutôt cauchemardesque malgré quelques rencontres avec des habitants de la ville. Il traine dans des quartiers misérables, éloigne avec difficulté des chiens sauvages. Il décrit un pays dont on peine à retrouver la grâce dans le désert. Un portrait du président autrichien de l’époque, admiré sur place et proscrit dans son propre pays (on songe à l’ancien SS Waldheim) donne le ton.
La ville rouge vers laquelle il se rend n’a pas de nom. On pourrait y reconnaitre une cité du nord de l’Europe, avec ses prostituées en vitrine, quelques images restent : « Des porches d’immeubles, orbites noires rivées sur moi. Venelles étranglées où flottent de nauséabonds relents d’urine ». La rencontre en ce lieu avec une prêtresse bouddhiste semble de l’ordre du fantastique. Ce que la conversation avec les morts, dans certains passages du roman rend possible.
Le narrateur trouve refuge dans la maison de son enfance, dans un chalet tout proche du lac. Il entend la voix de son père défunt. Celui-ci demande pardon à ses fils, se reproche sa dureté avec eux. C’est le moment de revenir en ville, retrouver Marc. Et grâce à Natasha, un nouvel amour, il a retrouvé le goût de l’instant, de son intensité. Il l’avait connu en Sicile avec Elena, puis perdu en se séparant d’elle.
Jusqu’alors divisé en chapitre, le récit a un titre vers sa fin : « Union ». Le narrateur divague, images et idées se mêlent tandis que son cœur, sa « toupie rouge » tourne follement. Mais une issue positive peut venir, dite en quatre phrases nominales, comme des étapes : « Grand voyage. Grand flottement. Communauté. La fin de la peur. »
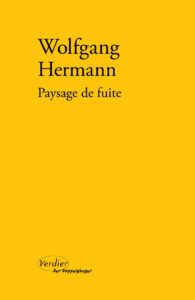 PAYSAGE DE FUITE
PAYSAGE DE FUITE
Wolfgang Hermann
éd. Verdier2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.