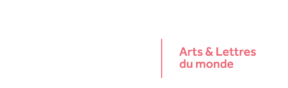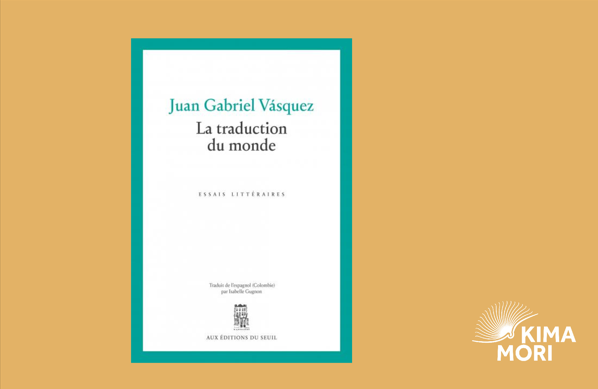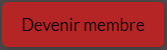Ce que seule la fiction peut
Vasquez est romancier. Tout son travail consiste à trouver une forme pour « raconter le mystère ». Tel est le titre de la troisième conférence donnée à Oxford en 2022. Il est colombien. Son pays, on le sait, a connu des moments difficiles et l’adjectif est euphémique : la guerre civile l’a déchiré, les trafics l’ont abimé, corrompu. Vasquez est né dans le pays de Garcia Marquez. Le grand romancier s’est donné une autre date de naissance que la sienne : né en 1927, il a prétendu l’être en décembre 28, moment d’un massacre dans les bananeraies du pays qu’il relate dans Cent ans de solitude. Coquetterie ? Pas vraiment. Désir plutôt de donner plus de sens à un événement jugé fondateur.
Quatre conférences se succèdent dans cet essai. Vasquez les présente comme « des notes griffonnées et élaborées afin de formuler correctement les questions. »
Formuler correctement les questions : c’est de Tchékhov. L’auteur ne répond pas aux questions. Il les formule. C’est difficile. Nous vivons avec les réponses, nous sommes submergés par elles. Tout semble avoir un sens, univoque, tout a une solution simple. Or ce que montre l’essayiste et romancier, c’est que l’incertitude règne, l’ambiguïté, et à travers certaines réflexions prenant appui sur ses confrères « praticiens » du roman pour reprendre le mot de Kundera, grâce à Proust, Yourcenar, Zadie Smith voire Paul Valéry (qui n’a jamais écrit le moindre roman), Vasquez traverse le genre à travers des thématiques comme celle de la place des autres, du mystère, du temps ou de cette liberté par laquelle il conclut, avec comme figure tutélaire le grand penseur libéral Isaiah Berlin.
Mais commençons par ce mot de traduction. Vasquez l’emprunte à Proust, cité en exergue. L’auteur du Temps retrouvé explique que le « livre essentiel » existe déjà en chacun de nous, et conclut : « Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur ».
Autrement dit, tout est prêt à naitre ou à se construire, pour autant que l’on trouve la forme : « la forme est l’ensemble des décisions – techniques, stylistiques, structurales – permettant à l’auteur d’extraire toutes les significations de son roman, de faire en sorte qu’il dise tout ce qu’il a à dire de la meilleure façon qui soit, afin que nous, les lecteurs, ayons l’impression que c’était la seule forme valable ». Une masse de romans parait, on devine que tous n’ont pas ce souci.
Parmi les questions qui se posent aujourd’hui, en un temps où le premier degré l’emporte, incapable de distinguer l’auteur du narrateur, il y a celle de ce qu’on appelle « appropriation culturelle ». Zadie Smith, inquiète, la déplore : « ce qui insulte, mon âme est l’idée – très populaire dans la culture actuelle, et présente à des degrés, variés de complexité – que nous pouvons, et devons écrire uniquement sur des individus qui sont fondamentalement « tels que nous » : racialement, sexuellement, génétiquement, nationalement, politiquement, personnellement. Que seule une intime connexion autobiographique, liant l’auteur aux personnages rend légitime la base d’une fiction. Je ne crois pas qu’il en aille ainsi, je n'aurais pas pu écrire mes livres si je le croyais. »
Ce rétrécissement du point de vue n’est pas le seul. La fiction est attaquée comme elle l’a été en d’autres temps, quand Platon ne voulait pas que le poète soit dans la cité. Socrate le signifiait en affirmant « qu’il n’y a point chez nous d’hommes qui réunissent les talents de deux ou de plusieurs hommes, et que chacun n’y fait qu’une seule chose. » L’aède Démodocos est cet homme de talent qui met en récit l’histoire d’Ulysse chez les Phéaciens.
La méfiance à l’égard de la fiction est ce qui conduit l’auteur du Lazarillo de Tormès ou Daniel Defoé à user de la lettre ou d’un récit véridique (un faux récit serait plus juste) pour faire lire leur texte. A la suite de Lazarillo viendront d’autres fictions comme Les aventures d’Augie March, de Saul Bellow. Mais James Joyce a bien compris que, l’air de rien, Robinson Crusoé a introduit avant Gorki et Dostoievski « les pires scories de la population : l’enfant trouvé, le pickpocket, le revendeur véreux, la prostituée, la vieille sorcière, le voleur, le naufragé. » En somme ce qui permet au lecteur d’évoluer, de comprendre le monde dans lequel il vit afin, écrit Vasquez, « d’y gagner la faculté de nous ancrer dans l’esprit d’autrui, puis en revenir lesté de tout ce qui l’anime ».
La fiction est le seul vrai moyen d’entrer dans le mystère humain. Vasquez reprend une phrase de Ford Maddox Ford, ami et biographe de Joseph Conrad voyant dans le roman « le moyen d’exprimer une discussion profondément sérieuse et contradictoire, par conséquent comme un support de choix pour des recherches tout aussi sérieuses sur le cas humain ». De cette faculté d’interpréter découlent les romans de Conrad, Sebald ou Javier Marias quant au mystère qui entoure nos vies, et celles de Carrère ou Cercas, dans lesquels le mystère qu’ils tentent d’élucider amène le narrateur à changer, et chez le romancier français comme chez son homologue espagnol, à comprendre les secrets d’un pays, de son Histoire comme de l’individu qui l’incarne, dans Limonov ou Les soldats de Salamine.
Incertitude, mystère, secrets : cela vaut aussi pour l’Histoire telle que l’appréhende le roman. Dans sa conférence intitulée Temps et fiction, Vasquez prend appui sur « Bilan de l’intelligence », une conférence donnée par Paul Valéry en 1935. Le poète et penseur s’interroge sur le présent. Ne résistons pas à l’envie de le citer : « le présent nous apparaît un état sans précédent, et sans exemple, cela est nouveau, l’on pouvait encore, il y a quelque trente ans, examiner les choses de ce monde sous un aspect historique, c'est-à-dire qu’il était alors dans l’esprit de tous, de chercher, dans le présent d’alors, la suite et le développement assez intelligible des évènements qui s’était produit dans le passé. La continuité régnait dans les esprits. » L’actualité récente semble nous signifier la même chose (en pire). Ce n’est pas sans effet sur la fiction et Vasquez d’ajouter : « les romans que je préfère en tant que lecteur, et ce que j’essaye d’écrire cherchent à rétablir cette continuité, brisée, à restaurer la condition historique de l’homme et à résister à la dés-historisation de notre expérience. » On connait le prix de l’oubli.
On s’amusera à lire le détail du raisonnement et là encore combien Vasquez a l’art de la dialectique. Borges explique dans une nouvelle de l’Aleph combien la balle qui atteint J.F Kennedy est ancienne. Plus « sérieux », Hadrien, héros de Yourcenar n’a guère confiance en les historiens qui « nous proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d’effets trop exacts et trop clairs pour avoir été entièrement vrais ». Or les failles ne manquent pas et selon Novalis, c’est dans ces manquements que naissent les romans. » Vasquez le dit à sa façon : « Je pense parfois que c’est là, dans cet espace d’incertitude et dans les verbes au conditionnel, qu’apparait la fiction. »
J’avais parlé de liberté, le mot clé. Les ennemis de la littérature et surtout du roman tel qu’il s’est incarné avec Cervantes, Flaubert, Virginia Woolf et de nombreux autres sont en général ennemis de la langue dans sa souplesse, sa richesse. Ils sont ennemis de l’ambiguïté et préfèrent le jugement péremptoire, la classification. Dans son ultime conférence, « Pour la liberté », Vasquez conclut : « L’histoire du roman moderne est une lutte pour dire ce qu’on croit ne pas avoir le droit de dire, et même pour penser ce qu’on croit ne pas avoir le droit de penser. » Salman Rushdie le sait, qui a failli payer cette lutte de sa vie.
Bien que bref, cet ensemble de conférences est, on l’aura compris d’une grande densité. Il donne à penser comme donnent à penser Les leçons américaines de Calvino et L’art du roman de Kundera. Le romancier est le plus à même de parler de son art. La culture de Vasquez et surtout son immense curiosité font le reste. Ce n’est pas peu.
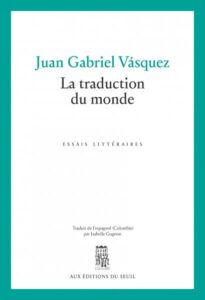 LA TRADUCTION DU MONDE
LA TRADUCTION DU MONDE
Juan Gabriel Vásquez
Traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon
éd. du Seuil 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.