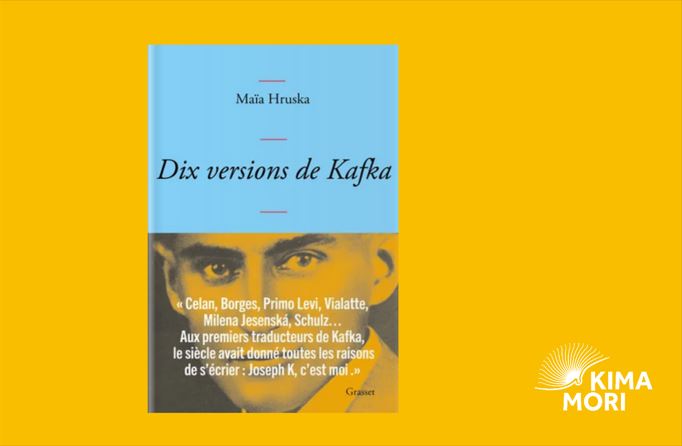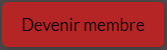Dix façons de comprendre Kafka
2024 est l’année anniversaire de la mort de Kafka. Les livres abondent, les commentaires fleurissent. Nous en avons l’habitude. Milan Kundera supportait mal ce qu’il nommait « kafkologie ». Outre les intentions politiques qui dévoyaient l’œuvre du romancier, il sentait chez des essayistes et philosophes un désir de se l’approprier pas plus honorable que la manipulation des idéologues.
Le premier mérite de Dix versions de Kafka, essai d’une jeune juriste très littéraire d’origine franco-tchèque, est de s’intéresser, d’abord à ses premiers traducteurs plutôt qu’aux textes de Kafka. Non que lire Le château, Le Procès ou La Métamorphose soient des choix indifférents, mais elle ne se pose pas en exégète, ce qui repose. Qui veut lire Kafka doit lire Kafka, et non les notes ou commentaires. Ou plutôt, on lit les exégèses après.
La liste des traducteurs est significative : Borges en espagnol, Bruno Schulz en polonais, Milena Jesenska en tchèque, Vialatte en français, Celan en roumain, Primo Levi en italien. Pour le yiddish, le poète Melech Ravitch s’adresse à une communauté ayant quasiment disparu. Pour l’hébreu, c’est plus compliqué : Kafka avait écrit en allemand, une langue devenue taboue après la guerre. Il aurait pu être traduit dès les années trente ; il ne le sera que vers 1970.
L’un des traducteurs sur lequel on a envie de s’arrêter est Bruno Schulz. Né à Drohobycz, en Pologne, c’est-à-dire nulle part, la formule de Jarry n’est pas galvaudée, il a traduit Kafka dès 1933. Schulz a connu différentes nationalités sans changer de ville. Il est né autrichien, est devenu polonais, puis soviétique, puis allemand avant que l’Ukraine dépendante de l’Union soviétique ne donne son nom à la ville.
Mais Schulz est avant tout l’un des plus grands écrivains de son pays (disons, la Pologne des années trente) avec Gombrowicz et Witkiewicz. Écrivain, nouvelliste, il est aussi peintre et illustrateur. Son œuvre dessinée, largement connue désormais, n’est pas sans lien avec des passages des romans de Kafka. Les femmes dominent, au propre comme au figuré. Maïa Hruska dresse un très beau portrait de Schulz dont la fin (prévisible pour un Juif en 1942) garde une dimension singulière. Le lecteur jugera. Nous ne présenterons pas tous les auteurs qu’elle évoque même s’il y aurait beaucoup à en dire tant les analyses de l’auteure le permettent. La façon dont Le château est arrivé jusqu’à Vialatte, alors en garnison en Allemagne, vers 1928 dit bien le rôle du hasard. Vialatte a été critiqué pour sa traduction.
Dès que Kafka est entré dans le domaine public, il a été traduit et nul n’a perdu au change. Bernard Lortholary, George-Arthur Goldschmidt, puis Jean-Pierre Lefebvre pour ne citer qu’eux ont donné à l’œuvre un nouvel éclat. On peut dire sans risquer de se tromper que la lecture de Goldschmidt, traducteur de Handke et surtout écrivain est le fruit d’une expérience intime. Enfant caché, enfant traqué, il avait survécu de justesse et certaines thématiques de Kafka étaient les siennes depuis toujours.
On pourrait terminer avec Milena Jesenska. La traduction en tchèque est le fruit ou l’écho d’une histoire d’amour. Laissons au lecteur le plaisir de la découvrir, ou de la retrouver.
 DIX VERSIONS DE KAFKA
DIX VERSIONS DE KAFKA
Maïa Hruska
éd. Grasset 2024
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.