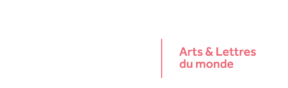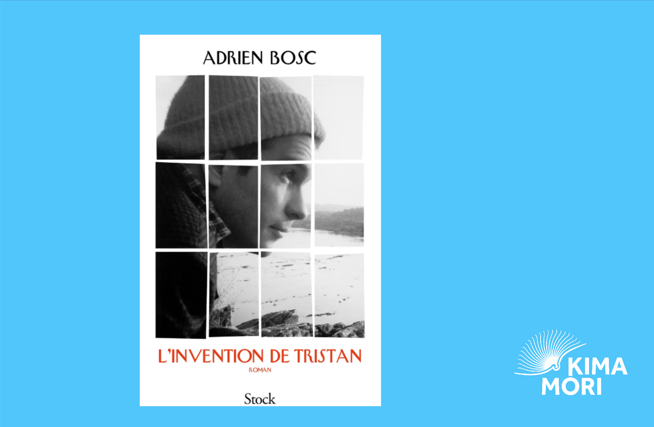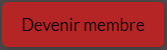Un romancier crée sa légende
Tous ceux qui lisent le manuscrit sont convaincus. Serge Chuvin, le traducteur, présente ainsi ce texte : « il ne jouait pas du tout le jeu du grand roman réaliste, psychologisant, globalisé, ni ne tombait dans les jeux postmodernes, la mise en abyme ou le clin d’œil référentiel… Je trouvais plutôt la littérature médiévale, le goût du mot rare – ce truc de la littérature américaine un peu sauvage, de se chercher des modèles, justement pas dans l’émergence du roman réaliste du XIXe siècle mais dans une survivance plus ou moins consciente de formes anciennes. »
Refusé par tous les éditeurs étasuniens, le roman parait chez Gallimard. Ce pourrait être le début d’une longue et féconde carrière. Le jeune romancier est « un être de tâtonnements et de malheurs » dit de lui Christine Jordis, son éditrice. Le conte de fées devient une tragédie quand l’écrivain rentre aux Etats-Unis, vit de petits boulots, boit et se drogue, révèle auprès de Hannah, sa compagne, sa « noirceur affreuse ». C’est un hypersensible, capable de la plus grande générosité, animé par la plus forte des révoltes contre la politique de son pays en Irak. Il devient incapable d’écrire, rate ses deux romans suivants dont un est publié de justesse à titre posthume. Il ne supporte plus de vivre et se suicide, très jeune.
Ecrire un livre culte c’est bien sûr entrer dans la légende, celle de Scott Fitzgerald, de Lowry ou de Roberto Bolaño, c’est aussi flirter avec le désastre, quelque forme qu’il prenne. En exergue du roman, une citation de Yourcenar indique les « trois lignes sinueuses » d’une existence : « ce qu’un homme a cru être, ce qu’il a voulu être, et ce qu’il fut ». Il est difficile de faire le partage pour Egolf. Une sorte de confusion demeure, liée à son héritage familial.
Il est le petit-fils de Warren Bing Evans, ancien combattant de la Première guerre mondiale, homme droit, humaniste, figure tutélaire pour Tristan car incarnant « héroïsme, dignité, courage, humilité ». Brad, son père, est très différent. Il a l’allure et l’âge pour être un hippie, un rebelle. Son parcours est tout autre et il choisit le camp d’une droite très conservatrice. Mais, partisan acharné de la vie comme valeur sacrée, il s’attaque aussi bien aux cliniques pratiquant l’avortement qu’aux bombardements massifs sur le Vietnam. Le sort tragique de ce père annonce un peu le sien.
Tristan ne laisse personne indifférent, pas plus que Warren ou Brad. Ses amis James et Shelly qui l’ont connu au temps de sa dèche à Paris, ou ses compagnons de squat à Alphabet City l’adorent et ne se remettront jamais de sa disparition. Marie, qui l’a hébergé après leur rencontre parisienne parle encore de lui dans un roman, longtemps après : « La fiction avait pris le dessus depuis longtemps sur la réalité et c’est cela même qui donnait de l’oxygène et qui parvenait, non sans mal, à le maintenir debout. Ainsi, en glissant chaque parcelle de vécu dans son œuvre et en sacrifiant tout afin de le transcender à travers l’écriture, il se consumait à petit feu sans s’en rendre compte. La voie vers la folie se traçait doucement d’elle-même. »
Que faire d’une telle histoire ? Comment, dans une fiction, parler d’une personne qui a existé, sans la trahir ni « faire les poubelles d’un mort » ? Telle est en effet l’objection de Camille, l’ex-compagne de Zacharie, et cette question vaut aussi pour Adrien Bosc. La limite est ténue entre la révélation impudique et le romanesque né d’une existence aussi brève et puissante. Au terme du roman, une vérificatrice pose à Zacharie de nombreuses questions avant que le portrait ne soit publié. La plupart portent sur des détails factuels. Le lecteur gardera les autres à l’esprit.
 L'INVENTION DE TRISTAN
L'INVENTION DE TRISTAN
Adrien Bosc
éd. Stock 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.