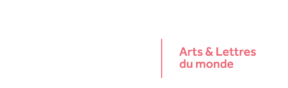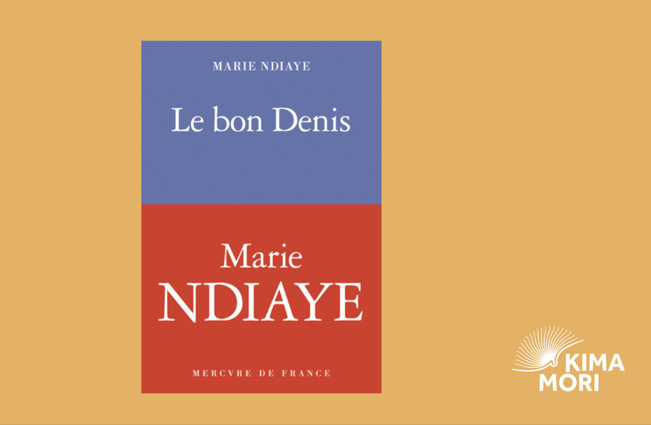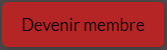Variations sur quatre Denis
Il est deux façons d’entendre Le bon Denis, titre du roman ou autoportrait romanesque de Marie Ndiaye récemment paru dans la belle collection Traits et portraits, dirigée par Colette Fellous. « Belle » n’est pas ici une facilité journalistique. De la couverture à la typographie choisie, en passant par le choix des photos qui illustrent chaque livre de la collection, on sent la présence d’une éditrice également romancière, après qu’elle a été une voix vespérale de France Culture. Nous reviendrons sur le choix des photos mais partons de ce titre, Le bon Denis, pour en dire le double sens.
Marie Ndiaye propose ici quatre variations sur un événement de son enfance : son père d’origine sénégalaise est retourné dans son pays d’origine peu après la naissance de Marie. Cette absence traverse l’œuvre de la romancière. La figure du père hante l’un des textes de Trois femmes puissantes, pour lequel elle a reçu le Prix Goncourt, Papa doit manger, pièce mise au répertoire de la Comédie française ou Autoportrait en vert, paru en 2005 dans la collection Traits et portraits.
Mais on peut aussi entendre bon au sens de vrai, d’authentique, le bon Denis est celui que l’on cherche ou que l’on croise à travers ces quatre récits qui entrent en écho les uns avec les autres. Entrons dans le labyrinthe aux miroirs.
Dans le premier récit donc, une narratrice se tient auprès de sa mère, dans une maison de retraite. Elle aimerait en savoir plus sur son père, « forme haute, vaste, éminente et sombre », tel qu’elle se le rappelle. La mère a en grande partie oublié son passé mais se souvient de ce « bon Denis » qui s’est occupé de Marie, « bon, trop bon, excessivement bon » entend la narratrice. Difficile pour celle-ci d’en savoir plus.
L’échange entre mère et fille a quelque chose de comique. La mère en veut à sa fille de l’avoir mise dans cette maison. La fille s’inquiète parce que des vêtements ont disparu. Elle-même mène une existence curieuse avec son mari, commerçant dans une petite ville du Gers où il vend des représentations de la Vierge. Ce mari obsessionnel intrigue : « Il tenta non pas, j’en suis convaincue, de mourir (c’est trop dur), mais de devenir, d’une seconde à l’autre, un homme mort ».
Le dialogue est à la fois amusant et bizarre. Pour dresser le portrait de Denis, et après une coupe de champagne, la mère compare la bonté de Denis à un parfum. Et tout à coup, une rencontre, des recherches sur internet font émerger un autre Denis, ou des Denis. Il est peut-être Flora, Régis, Sylviane, Maria, Alain. Ou nulle part. On s’est laissé envoûter. L’écriture de l’autrice est toute en faux-semblants et chausse-trapes.
Le deuxième récit met en regard deux histoires et deux espaces : le Sénégal du père, la Beauce maternelle. Des photos font les liens, instantanément, montrant la région de Pithiviers ou celle dans laquelle grandit le père. Denis réapparait mais qui lira découvrira. Ce récit-là relate des vies parallèles, instants d’enfance, avec des échos, résonances, et oppositions. La disposition du texte par fragments espacés rend la distance entre les lieux, les êtres. Les sonorités disent la dimension poétique de ce deuxième récit comme les contes, celui d’Issa-longues-jambes et de Cendrillon donnent à l’existence de ces deux êtres une dimension supplémentaire. Rien chez Marie Ndiaye, ne se réduit au « réel ».
Le troisième récit met en lumière le vrai motif du départ brutal. Nous n’en dirons rien, sinon qu’il se déroule dans la Beauce et repose sur une litanie fondée sur un « Enfant, j’ai toujours cru », voire « J’ai, enfant, toujours cru », qui devient soudain « J’ai toujours cru, adulte, que mon père n’était finalement, qu’un sale type : un homme sans honneur. » Mémé et Pépé, les grands-parents de la narratrice donnent un prénom au père : ce sera Denis. Quant à leur petite fille, ils la trouvent laide, trop semblable au père et se laissent aller, « comme on parle devant lui d’un chien, de ses défauts, sachant qu’il ne peut pas comprendre (…) »
Le quatrième récit raconte des retrouvailles dans un luxueux hôtel à Los Angeles. Deux photos se font écho. Sur la première, on voit un superbe bâtiment illuminé, au bout d’une allée bordée de palmiers. La jeune héroïne va emprunter ce chemin, après avoir connu quelques déboires mis sur le compte d’un malentendu avec le père. La seconde clôt le récit et le livre. On distingue des bâtiments couleur or sur fond nocturne mais l’image est floue. On lira pourquoi. Le récit débute sur des exclamations, des affirmations. Elles traduisent l’espoir de la fille ici désignée par la troisième personne.
Le verbe croire que l’on trouvait dans le deuxième récit prend tout son sens ici : « Comme les obligations de la vie, comme la nécessité de se faire un nom, comme le désir forcené de se tirer soi-même par les cheveux pour se hisser au-delà de toute modicité imaginable, avaient dû tarauder le père ! »
L’héroïne attend en effet de revoir son père, persuadée qu’il dirige ce prestigieux endroit. On devine la suite. Un autre Denis apparait, lors d’une morne soirée dans ce lieu trompeur, aussi trompeur qu’un père assis au pied d’un buisson, et qui prétend n’avoir jamais eu d’enfants.
 LE BON DENIS
LE BON DENIS
Marie NDiaye
éd. Mercure de France 2025
parution le 9 avril
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.