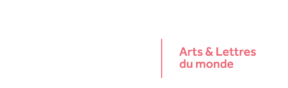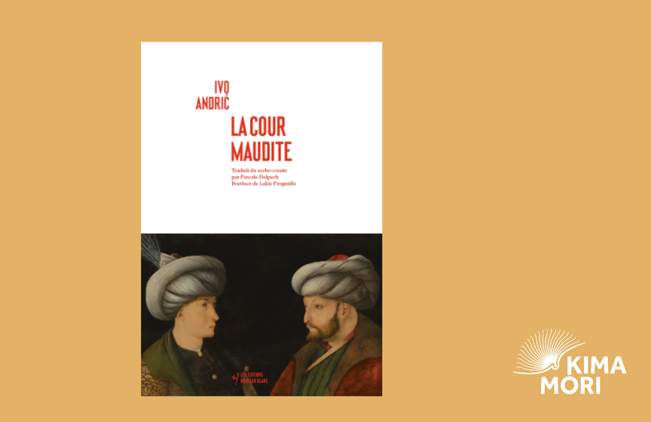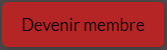Un roman entre Balkans et Orient
Nous sommes au XVIIIème siècle. Dans son monastère en Bosnie, on enterre Fra Petar, et on fait l’inventaire de ses outils. Il était un « célèbre horloger, armurier et mécanicien ». Ce détail n’est pas inutile. Il y a bien longtemps, ce moine a été enfermé dans la Cour maudite, une prison d’Istanbul. Il a côtoyé tout ce que la pègre et les marges peut assembler de figures contrastées, et il a par la suite raconté l’histoire, centrale dans le roman, de Kamil, un jeune homme de grande stature, un intellectuel enfermé dans ce lieu infernal. Ce Kamil, fasciné par un certain Djem, frère cadet du sultan Bajazet, a été à la Renaissance, l’objet de marchandages et d’humiliations entre l’Occident chrétien et le monde Ottoman. Une existence exemplaire, à sa façon.
Andric appartient à la grande tradition du roman comme le rappelle dans sa riche postface Lakis Proguidis. Selon lui, il est un héritier de Tolstoï. On pourrait dire aussi sans risque de se tromper que son œuvre est à la charnière de deux mondes, occidental et ottoman, comme le pont sur la Drina dont on lit la chronique à travers les siècles fait le lien entre ces deux espaces.
L’œuvre est imprégnée par le conte oriental, et qui dit conte dit oralité. Cela se manifeste de diverses façons et ici par l’enchainement subtil des narrateurs. Petar, enfermé dans la vaste salle de la prison écoute le récit de la bouche de Haïm, un Juif de Smyrne qui se sent persécuté, parle sans s’arrêter, au risque de la répétition. Petar, en horloger méticuleux, ne rend pas toutes les redites ou hésitations de son voisin de détention. Haïm lui parle des rancœurs et jalousies qui animent le quotidien de sa cité d’origine, des vengeances qui en découlent et qui l’ont conduit dans cette vaste salle, mais à l’écart des pires brutes. Il lui raconte l’histoire de Kamil, un jeune smyrniote victime de sa passion toute intellectuelle pour Djem. Le jeune homme a un temps été enfermé dans cette même salle immense de la Cour maudite et un lien très fort a uni le Turc et le Bosnien qui communiquaient dans plusieurs langues.
A son tour Kamil raconte à Petar ce qu’il a vécu et subi, jusqu’à se retrouver en prison. Le roman s’achève où il a commencé, en Bosnie, alors que ses compagnons veillent le mort.
Dans un essai intitulé Trois anneaux, Daniel Mendelsohn analysait avec clarté et simplicité cet art du récit fait de retours en arrière ou de récits dans le récit qui ont le pouvoir de nous envoûter et souvent de nous surprendre. La Cour maudite est une construction toute simple dans laquelle chaque narration éclaire la précédente, l’amplifie parfois, ou éclaire la personnalité d’un personnage, qu’il soit le détenu au présent, Kamil, ou le détenu au passé, Djem. Le lien entre ces deux hommes victimes de leur modération, de leur intelligence et de leur désir d’apprendre est au cœur du roman.
Mais la « périphérie » est d’une richesse extrême. On s’en voudrait ainsi de ne pas évoquer Latif Aga, dit Karagöz, directeur de la Cour maudite. Son portrait occupe tout un chapitre du roman. Un portrait physique bien sûr, mais aussi et surtout en actions. Il est une incarnation de la perversité, mêlant coupables et innocents, souvent plus généreux avec les premiers qu’avec les seconds qu’il a l’art de torturer (plutôt par le tourment qu’avec des instruments manipulés par des brutes). Karagöz est un vrai méchant, comme on aime en trouver dans une fiction. Un méchant qui ne le fut pas enfant ou jeune homme, un méchant complexe, insaisissable. Javert est monomaniaque, obsédé par une justice impossible, Vautrin n’a jamais accédé au poste de chef de la police comme l’a fait Vidocq, son modèle. Karagöz a appris le métier grâce à son père et il a régné pendant vingt ans sur sa prison. Mais il n’aimait pas les prisonniers politiques, ne sachant comment les traiter, et Kamil en est un, avant d’être traité comme un fou.
La dimension politique n’est pas absente du roman. D’abord parce que l’Empire Ottoman est une mosaïque de peuples et de religions, un lieu de mélanges, en cela symétrique de l’Empire austro-hongrois. La mère de Kamil est grecque comme celle de Djem est serbe. Haïm est juif dans une ville de Smyrne partagée entre Turcs musulmans et grecs chrétiens. Djem comme Kamil sont en marge de leurs communautés turque et grecque. Leur indépendance d’esprit, leur goût pour les livres passe au mieux pour de la folie, au pire pour de la subversion. Dans ces communautés, on tient à préserver l’identité. On pourrait multiplier les exemples et ainsi s’interroger sur le sort de Djem face à son frère ainé, sultan gouvernant le pays : il est une monnaie d’échange entre D’Aubusson, un catholique très ambitieux, le Pape qui a des velléités guerrières, et le souverain ottoman qui manœuvre. Otage ou banni, Djem n’a pas beaucoup de choix.
Mais la dimension géopolitique est également très puissante si on lit ce roman à l’aune de notre présent. En 1961, Andric, citoyen yougoslave, était un « non-aligné », un représentant parmi d’autres d’un pays qui, comme l’Inde, le Brésil ou l’Egypte faisait partie du « Tiers-Monde ». Aujourd’hui, on le sait, les Balkans ont explosé, les nationalismes se sont partout réveillés et avec eux les mouvements religieux identitaires. La Turquie est au cœur de bien des conflits et Smyrne, devenue depuis longtemps Izmir n’a plus grand-chose de grec. Les fractures que décrit Andric dans ce roman comme dans Le pont sur la Drina sont plus aigües encore.
Enfin, n’oublions pas ce qui vaut à Djem et à Kamil d’être persécutés : ils se sont placés hors du monde et de ses vanités, ils sont loin des Cours et de leurs intrigues, ils aiment les livres et passent de ce fait pour des suspects. Nous ne sommes pas dans le monde de Rushdie, de Saviano ou des scientifiques étasuniens d’aujourd’hui, mais on ne peut s’empêcher de penser à ces cibles contemporaines en lisant les réactions d’un vali – fonctionnaire de second ordre – face aux nombreux livres accumulés par Kamil ou celles des deux sous-fifres de Karagöz qui l’interrogent sur le but de ses recherches historiques consacrées à Djem. Ils ne peuvent concevoir que ce jeune érudit étudie pour rien. Il prépare une rébellion.
La Cour maudite est un roman d’une très grande richesse. Il est tout en clair-obscur, en recoins que l’on explore. Aux Petar, Kamil voire Haïm qui tentent de donner sens à ce qu’ils vivent, on peut ainsi opposer la masse des détenus qui ne cessent de parler (avec la délicatesse que l’on devine) de femmes désirées, conquises ou soumises, brutes qui ne cessent de montrer leurs muscles et de s’insulter avant de s’affronter. Ivo Andric décrit ce monde dans son style chatoyant, sensuel, dont la traduction de Pascale Delpech rend toute la beauté.
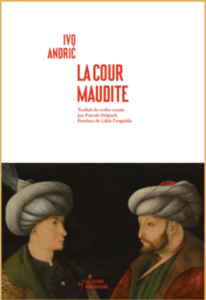 LA COUR MAUDITE
LA COUR MAUDITE
Ivo Andric
Traduit du serbo-crote par Pascale Delpech
postface de Lakis Proguidis
éd. Noir sur blanc 2025 (v.o. 1954)
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.