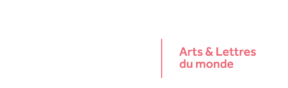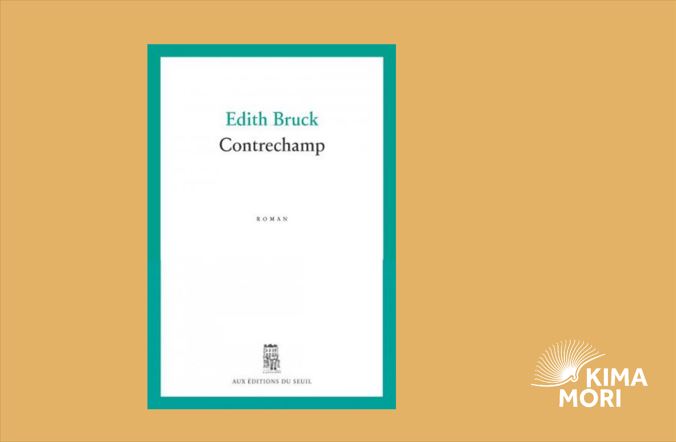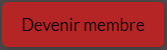Maquiller l'Histoire
Contrechamp est un roman. Il met en scène Linda, une ancienne déportée d’origine hongroise. Le « je » employé montre la proximité entre l’autrice et son héroïne. Nous lisons là une légère transposition d’une expérience vécue par Edith Bruck en 1960 et la fiction réside dans la fusion des épisodes du pantalon et du tournage du film. Elle avait alors été appelée par Gilles Pontecorvo comme consultante historique sur le film Kapo tourné en Yougoslavie. Ce film, on le sait, suscitera des polémiques pour un plan. Citons Le Monde lors de la réédition du film en DVD (3/8/2006) : « Kapo, réalisé par Gillo Pontecorvo en 1960, en est l'illustration par excellence en France, où deux textes plus célèbres que lui - De l'abjection de Jacques Rivette (Les Cahiers du cinéma, no 120, 1961) et Le Travelling de Kapo de Serge Daney (Trafic, no 4, 1992) - l'ont voué à une durable indignité, au nom d'un plan dans lequel le réalisateur recadrait en travelling le cadavre d'une déportée par pur souci d'esthétisme ». En la matière, on le verra, il importe d’être très précis et délicat.
De « faux rails » sont battus par un « faux vent et une fausse pluie ». L’actrice américaine porte une perruque masquant ses cheveux sous une apparente calvitie et des figurantes se sont rasé le crâne pour recevoir un peu plus d’argent. Le metteur en scène lance des mots en allemand, sans se soucier de leur écho pour Linda. Ou plutôt, par perversité, en le sachant parfaitement. Et ce tyran au petit pied veut absolument faire du médecin qui soigne Linda après l’agression subie, le médecin du camp dans le film.
Les comédiennes comme les figurantes tiendront difficilement le choc. La narratrice aura plus de chance, pouvant quitter les lieux du tournage deux jours avant l’échéance prévue. Il lui faudra voyager en avion avec un groupe d’étudiants qui, voyant l’étoile de David qu’elle porte au cou se distingueront bien peu du marchand de pantalons.
Contrechamp est un roman qui secoue. Bref, sec dans son écriture, il rend bien compte de la difficulté, voire de l’impossibilité de figurer un événement comme la déportation et le génocide. Rares sont les cinéastes qui sont parvenus à montrer le camp, en dehors de Jonathan Glaser dans La zone d’intérêt. Il a montré sans montrer. Dans une tentative voisine, on peut citer Le fils de Saül, de Lazlo Nemes, qui adoptait de façon stricte le point de vue du personnage, sans rien montrer du camp. Claude Lanzmann l’avait senti et montré dans Shoah : la voix et le regard des témoins restent les plus sûres façons de raconter ce qui n’a pas de sens.
En même temps que le roman, des poèmes d’Edith Bruck paraissent chez Rivages qui publie cette partie de son œuvre. Ils tracent des portraits d’êtres aimés, rapportent en scènes courtes des traitements brutaux envers des personnes âgées qui attendent la fin dans des maisons de retraite. Tels des faits divers n’appelant pas de commentaire, juste de la rage ou de la colère ils relatent aussi des comportements masculins ayant longtemps connu l’impunité. Elle-même, toute intellectuelle et artiste connue et reconnue a subi la prédation.
Tous ces poèmes sont autant de dissonances, pour reprendre le titre qu’elle a choisi. Edith Bruck écrit des vers brefs, sans recherche d’images, sans artifice. Des poèmes qui disent combien le monde d’aujourd’hui continue de susciter son attention.
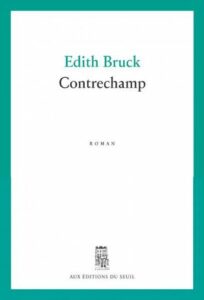 CONTRECHAMP
CONTRECHAMP
Edith Bruck
Traduit de l'italien par René de Ceccatty
éd. Seuil 2025
Article de Norbert Czarny.
Norbert CZARNY a enseigné les Lettres en collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à La Quinzaine littéraire, En attendant Nadeau et L’École des Lettres. Son dernier livre, Mains, fils, ciseaux, éditions Arléa, est paru en 2023.